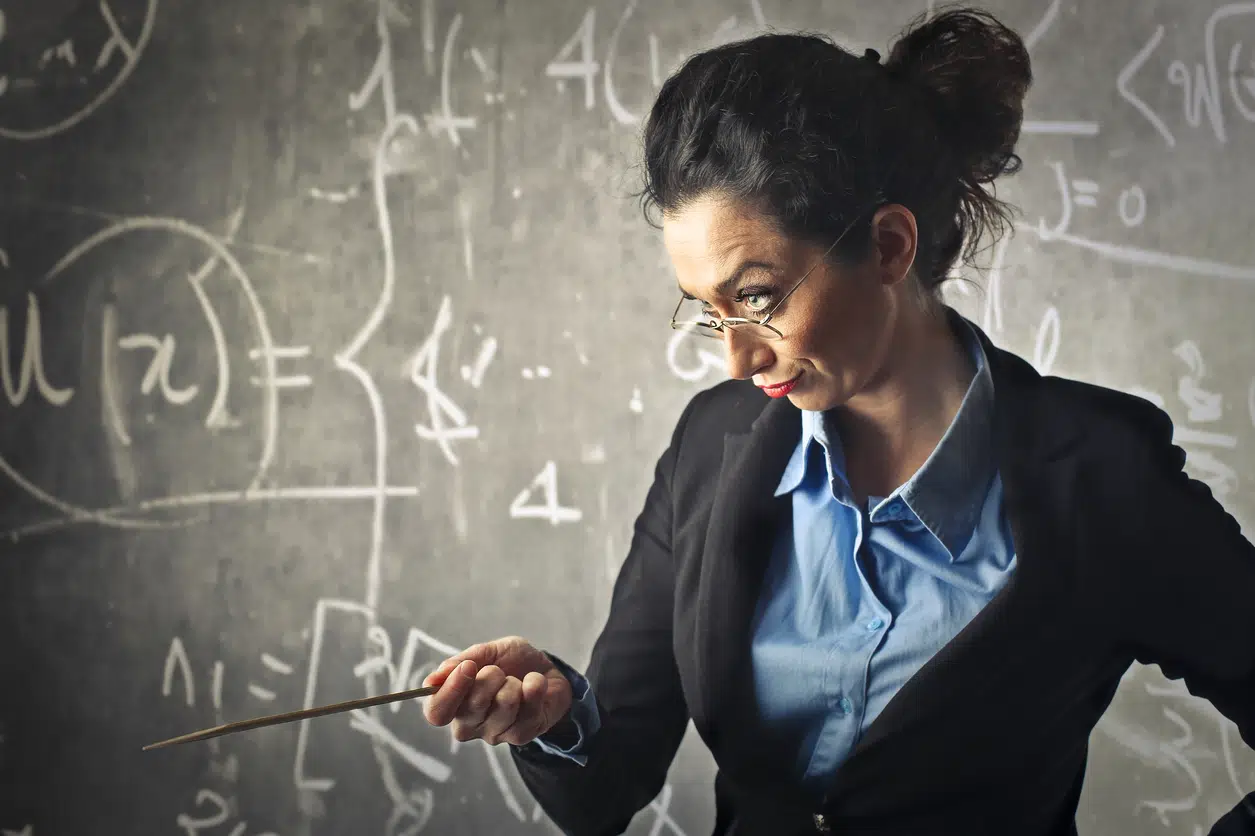Entre 6 et 8 % des élèves présentent au moins deux troubles spécifiques des apprentissages, selon les dernières estimations de l’Éducation nationale. Malgré la loi de 2005 sur l’inclusion scolaire, la mise en œuvre des adaptations reste hétérogène d’un établissement à l’autre. Les familles et les équipes pédagogiques se heurtent encore à des délais de diagnostic longs, à une formation inégale des enseignants et à des ressources limitées.
Les répercussions ne se limitent pas aux résultats scolaires : elles s’invitent dans l’estime de soi et la maîtrise des savoirs fondamentaux. Pour que l’accompagnement ait un impact, il faut s’appuyer sur la détection précoce, une collaboration entre professionnels et une adaptation sur mesure en classe.
Enfants multi-dys : mieux cerner des troubles souvent méconnus
Un enfant multi-dys affronte chaque jour simultanément plusieurs troubles spécifiques des apprentissages. Derrière une difficulté qui saute rarement aux yeux se cachent des interactions complexes : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, parfois associées à un trouble du développement de la coordination ou à un trouble du déficit de l’attention. Cet entremêlement rend le repérage délicat et la prise en charge, morcelée.
Les signes de ces troubles développementaux passent facilement inaperçus : une écriture hésitante, un rythme de lecture lent, des blocages devant les nombres ou la géométrie, un geste maladroit pour lacer ses chaussures. L’enseignant cherche à ajuster ses pratiques, jongle avec les adaptations, tente différentes évaluations. Mais la réalité va bien au-delà d’un simple problème scolaire : organisation, mémoire, gestion de la fatigue ou du stress, tout est à réinventer.
Face à ces défis, il existe des manifestations caractéristiques, résumées ainsi :
- La dyslexie gêne l’apprentissage de la lecture et la compréhension des textes.
- La dysorthographie pose des obstacles à l’orthographe et à l’expression écrite.
- La dyscalculie complique les calculs et la manipulation des chiffres.
- Un trouble développemental de la coordination engendre maladresses et difficultés dans les activités physiques de précision.
Lorsque plusieurs de ces troubles s’accumulent, chaque année scolaire se transforme en parcours sinueux. Pour y voir clair, la vigilance collective, familles, enseignants, professionnels de santé, reste le meilleur atout. Beaucoup d’enfants multi-dys expriment encore un sentiment d’incompréhension ou se sentent en décalage avec leur entourage.
Quels obstacles rencontrent-ils au quotidien à l’école ?
Derrière la porte de la classe, les enfants multi-dys naviguent à contre-courant. Plus qu’une gêne à lire ou à écrire, ce sont les exigences d’organisation, la rapidité des consignes, ou le flot sonore permanent qui pèsent lourd. L’environnement scolaire ne ménage que rarement le temps dont ces élèves auraient besoin pour intégrer les apprentissages.
Il suffit, parfois, d’une consigne donnée aussi vite qu’oubliée, sans support visuel ni reformulation. Devant un texte dense ou une consigne complexe, l’élève flanche, piétine, décroche. Pour d’autres, écrire ou poser convenablement une opération relève d’un combat permanent. Prendre des notes tout en écoutant se révèle presque impraticable. La fatigue s’accumule, la confiance s’effrite, le sentiment d’être en marge s’installe.
A la récréation aussi, les troubles moteurs et attentionnels rappellent leur présence. Jeux collectifs ratés faute de coordination, gestes hésitants, isolement silencieux. Le bruit, la pression du groupe, déclenchent parfois des troubles de l’attention ou aggravent l’hyperactivité.
Voici quelques obstacles concrets souvent rencontrés durant la journée :
- Un regard extérieur peu bienveillant qui fragilise la motivation.
- Des corrections d’erreurs répétées qui sapent la confiance en soi.
- L’absence d’adaptations pédagogiques freinant la progression et l’autonomie.
Pour eux, la classe prend vite des allures de parcours d’obstacles. Avancer malgré tout, trouver la force de chaque matin recommencer, c’est tout l’enjeu de ces élèves courageux.
Des pistes concrètes pour faciliter l’apprentissage en classe
Outil majeur dans l’école inclusive : le plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Construit en lien avec les équipes éducatives, il permet d’agir sur différents leviers : donner du temps en plus lors des évaluations, simplifier les consignes, recourir à la dictée à voix haute… Tout ce qui soulage la charge cognitive et soutient la progression compte.
Quand la situation l’exige, le projet personnalisé de scolarisation (PPS) s’impose. Il permet l’accès aux dispositifs spécialisés (comme les ULIS), sans couper l’élève de son environnement de classe ordinaire. Le soutien spécialisé fait alors toute la différence.
Parfois, une aide technologique bouleverse le quotidien : ordinateur avec logiciels adaptés à la lecture, correcteurs d’orthographe, outils de dictée vocale. Pour beaucoup d’enfants avec dyslexie ou dysorthographie, c’est un sésame pour suivre le rythme.
Les stratégies d’adaptation peuvent s’organiser autour de ces points :
- Utiliser des supports visuels et des schémas paraît déterminant pour rendre accessibles des notions abstraites.
- Découper les tâches et formuler des consignes courtes, tant à l’oral qu’à l’écrit, aide à limiter la surcharge.
- Investir dans la formation des enseignants permet de mieux comprendre les troubles spécifiques des apprentissages et d’adopter des pratiques plus inclusives.
Le dialogue entre enseignants, professionnels de santé, familles, dessine une dynamique de progrès. L’école peut ainsi devenir un lieu où chaque élève trouve les moyens d’avancer, à son rythme, sans stigmatisation ni mise à l’écart.
Ressources utiles pour aller plus loin et soutenir les familles
Pour un parent, le chemin vers une scolarité adaptée ressemble parfois à une course d’endurance : prise de rendez-vous, constitution de dossiers, délais administratifs… Première étape structurante : la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). C’est là que se montent les dossiers pour solliciter aménagements et dispositifs ou demander un projet personnalisé de scolarisation (PPS), après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Associations et collectifs de parents constituent de précieux relais pour soutenir et orienter, qu’il s’agisse d’organiser des groupes de parole, de suivre l’évolution des textes réglementaires ou de conseiller sur le montage d’un PAP et l’accès aux aides.
Pour ne pas s’y perdre, il est conseillé de s’appuyer sur plusieurs ressources :
- Les guides pédagogiques publiés par le ministère de l’éducation nationale aident à comprendre les dispositifs disponibles et les démarches à entreprendre.
- Le service social de l’établissement scolaire et l’enseignant référent handicap sont en première ligne pour accompagner et orienter les familles.
Dans plusieurs académies, la Plateforme TEDI (Troubles spécifiques des apprentissages et du développement) a fait ses preuves : elle favorise l’accès au bilan, aide à coordonner les professionnels, et fait le lien entre santé, école et famille. Pour les situations qui se compliquent ou tardent à trouver une réponse adaptée, les centres de référence des troubles du langage et des apprentissages hébergés en CHU constituent une ressource précieuse.
S’entourer, échanger, et garder le fil des évolutions grâce à l’entraide parentale permet d’ouvrir d’autres perspectives. À force de persévérance, même le chemin le plus accidenté finit par livrer ses propres sentiers, parfois là où on ne les attendait pas.